La venue de Charles-Quint à Beaumont
En cette année 1549, l’Empereur Charles-Quint a pris une ferme décision, qu’il mûrit de longue date : las des affaires du gouvernement et miné par des problèmes de santé, il désire abdiquer. Son immense Empire, sur lequel, dit-on, le soleil ne se couche jamais, cet Empire sera partagé en deux. Son frère Ferdinand recevra l’Autriche et l’Allemagne ainsi que le titre d’Empereur. Son fils Philippe II dirigera pour sa part les possessions d’Italie, l’Espagne et les colonies prometteuses du Nouveau Monde. Il ajoutera à son royaume les XVII Provinces des Pays-Bas que son père aime tant.

L’Empereur a pris soin de préparer sa succession. En imposant en 1548 la Transaction d’Augsbourg et l’année suivante la Pragmatique Sanction, Charles a fait des XVII Provinces, jusque là indépendantes les unes des autres, un seul et même État, indivisible et transmissible par succession héréditaire. Selon ses vœux, par conséquent, les provinces qui forment aujourd’hui le Bénélux devraient rester durablement unies, malgré leurs différences de langues, de religions, de mentalités. Un bloc dressé comme une barrière contre la France, l’éternelle rivale. C’est à son fils Philippe qu’il compte en laisser la direction. Celui-ci a alors 22 ans. A la différence de son père né à Gand et élevé chez nous, Philippe a reçu une éducation espagnole et n’a pour ainsi dire jamais quitté l’Espagne. Il connaît mal les Pays-Bas, il en ignore les coutumes et le caractère. Il ne parle ni le français ni le flamand. Son tempérament plutôt distant, froid, contraste avec la jovialité légendaire de Charles-Quint. C’est un jeune homme un peu guindé, peut-être timide, en tout cas peu démonstratif.
L’Infant Philippe doit donc être présenté à ceux qui seront bientôt ses sujets et qui ne le connaissent pas encore. Il quitte l’Espagne fin 1548. Par l’Italie et l’Allemagne, il gagne les Pays-Bas. Il entre à Namur en grandes pompes le 29 mars 1549. Le 1er avril, il est accueilli à Bruxelles par son père Charles-Quint. En juillet, tous deux visitent les villes des Pays d’Embas : Louvain, Gand, Bruges, Ypres, Lille, Tournai, Arras et Valenciennes. Viennent ensuite Landrecies, Chimay, Mariembourg et… Beaumont où Charles et son fils sont reçus par le Comte Charles de Croy, le 21 août 1549… Ils passeront la nuit au château comtal, disparu aujourd’hui presque totalement. C’est à ce moment que l’Histoire devient une Légende…
L’aigle doré

La légende des Douze Bourgeois Stocquarts de Solre-Saint-Géry
A Solre-Saint-Géry, douze villageois ont un jour prêté main forte à leur seigneur. Celui-ci ne fut pas ingrat : il les fit Bourgeois de Beaumont. Légende ou réalité ?

Une légende beaumontoise (une de plus) raconte qu’un jour le seigneur de Beaumont rentrait en son château. Il pleuvait à verse, les chemins étaient boueux et, à Solre-Saint-Géry, sa voiture s’enfonça dans une profonde ornière. Douze paysans le tirèrent de ce mauvais pas et le ramenèrent à Beaumont à bras sur une litière de branchage. En récompense, le comte les créa bourgeois de Beaumont (1).
Coïncidence curieuse, une histoire semblable se retrouve dans le Brabant flamand, à Tombeek plus précisément où des habitants, un jour de pluie, auraient aidé des voyageurs à dégager leur voiture enlisée dans la boue. Tout comme chez nous. A cette différence près, mais elle est de taille, qu’au nombre des infortunés passagers se trouvait l’Empereur Charles-Quint en personne. Le souverain voulut remercier sans tarder les serviables villageois et leur octroya de multiples faveurs : c’était bien la moindre des choses. Depuis lors, pour rappeler cet événement, les habitants de Tombeek ont également l’insigne privilège d’ouvrir en fanfare le fameux cortège bruxellois de l’Ommegang.
Nos douze habitants de Solre-Saint-Géry reçurent quant à eux le titre de bourgeois stocquarts ou stocquault et figurent sous cette appellation dans maints documents anciens de la Ville de Beaumont. Leur nom n’est pas sans évoquer le vieux français estoc, qui signifie le bâton, le pieu, la bûche, le tronc ou encore la souche d’arbre (2). Allusion aux pieux qu’ils utilisèrent pour tenter de dégager la voiture de leur maître ou aux branchages dont ils firent la litière sur laquelle ils le transportèrent ensuite ? C’est en tout cas ce qu’affirme la tradition. Celle-ci est-elle fondée ? Et les deux histoires, celle de Solre et celle de Tombeek, sont-elles apparentées ? Impossible à dire. A moins qu’il faille parler ici aussi de légendes ?
Quoi qu’il en soit, nous savons avec certitude que le titre de bourgeois stocquarts se transmettait de père en fils. Lorsque l’un des douze mourait sans descendance, un tiers pouvait acheter la place laissée vacante entre les mains du maire et des échevins de Beaumont. De leur vivant, les bourgeois stocquarts étaient exemptés de certaines taxes prélevées sur les marchés, au passage de marchandises sur les routes ou les ponts appartenant au seigneur de Beaumont (3). A leur mort, cependant, leurs héritiers devaient remettre au seigneur de Beaumont le plus bel objet de la succession, ce que l’on appelait alors le meilleur catel (4).
En tout cas, si la légende dit vrai (et comment, un jour comme aujourd’hui, pourrions-nous croire le contraire ?), les habitants de Solre-Saint-Géry avaient une fois de plus fait la preuve de leur grand courage et d’une loyauté sans faille envers leur seigneur. De telles qualités devaient être mises en exergue.

C’est pourquoi les douze bourgeois stocquarts avaient eux aussi le droit de participer à notre cortège aux côtés du Comte de Beaumont. Et pour tenir leur rôle, pas question de figurants issus de n’importe où : les costumes des bourgeois stocquarts ne pouvaient être confiés qu’à des habitants du cru, à des Solréziens pure … souche, bref, à de véritables Turcs.
Des Turcs ? Oui, mais c’est une autre histoire…(5).
(1) BERNIER, Th., Histoire de la Ville de Beaumont, dans Mémoires et Publications de la Société des Arts et des Lettres du Hainaut, IVème série, t. 4, Mons, 1878, pp. 178 -179, note n°5.
(2) L’ancien droit d’estocage consistait d’ailleurs à pouvoir ramasser les vieilles souches dans les forêts seigneuriales. Cette origine est sans doute aussi celle de nos fameux astokeus et destokeus du Grand Feu de Barbençon : armés de cales en bois qu’ils placent sous les roues du charriot, les astokeus cherchent à empêcher la progression du véhicule dans les rues du village, tandis que les destokeus s’évertuent à débloquer la situation à l’aide de pieux d’une épaisseur appréciable. Le tout au plus grand péril de leurs orteils, mais dans une ambiance des plus sympathique !
(3) II s’agit de péages nommés tonlieux, winages et pontenages pour lesquels les bourgeois stocquarts étaient exemptés à l’intérieur d’un assez large périmètre géographique (MATTHIEU, E., Le Besoigné ou Description de la ville et comté de Beaumont, dans Annales du Cercle Archéologique de Mons, t. 16, 1880, p. 228). Manifestement, le seigneur de Beaumont avait voulu favoriser une activité d’ordre commercial, peut-être liée à la vente du fer dont la production est attestée dès les débuts du Moyen Age dans la région.
(4) La disposition relative au meilleur catel semble indiquer que les bourgeois en question étaient en réalité d’anciens serfs, c’est-à-dire des paysans non libres, affranchis au moins partiellement par leur seigneur à une époque indéterminée.
(5) Turcs est en effet le surnom (le spo) donné aux habitants de Solre-Saint-Géry. D’où vient-il ? Encore un mystère ! Certains racontent qu’au onzième siècle, lorsqu’il prêchait la première croisade contre les Arabes, Pierre l’Ermite en personne vint dans le village y recruter des volontaires. Devant le peu d’ardeur guerrière manifestée par les villageois, le saint homme finit par s’emporter, les qualifiant de paresseux, de mauvais chrétiens, presque de Musulmans, puisqu’il finit par leur dire : « Vos n’astez qu’une bînde de Turcs ! ». Ces paroles sont-elles authentiques ? En tout cas, le lecteur voudra bien noter que ce fut la première et la dernière fois que l’envoyé du pape s’exprima en wallon…
La pendaison
La pendaison est un acte de violence dans lequel le corps pris par le cou dans un lien attaché à point fixe et abandonné à son propre poids exerce sur le lien suspenseur une traction assez forte pour amener brusquement l’arrêt de la circulation cérébrale, l’arrêt des fonctions respiratoires et enfin, la mort.
La pendaison a différents effets suivant qu’elle entraîne ou non une rupture de la nuque.
Dans le premier cas, la mort est provoquée par la dislocation des 3éme et 4éme vertèbres cervicales. Elle est instantanée.
Dans le second cas, la pendaison provoque des lésions cartilagineuses au niveau du larynx, ainsi que des lésions nerveuses des veines jugulaires et des artères carotides. Elle provoque également une obstruction plus ou moins complète des voies aériennes supérieures, entraînant une occlusion des vaisseaux du cou. L’anoxie cérébrale débute alors dès la première seconde et provoque une perte de conscience immédiate. Un œdème cérébral se développe rapidement et empêche la souffrance cérébrale.
Le pendu développe des lividités aux membres supérieurs, entre le coude et les doigts, et aux membres inférieurs entre les genoux et les pieds. Son visage est blême, parfois cyanosé, la langue est protuse et les yeux injectés de sang. Le cou présente une lésion cervicale reproduisant les marques de la corde, interrompue au niveau du nœud. La peau en regard de ce sillon est brillante, blanchâtre, colorée avec le temps par parcheminement. Le pendu présente parfois une érection importante. (Dr VANTRIMPONT 21.06.2000).
Origines
L’origine de la pendaison est impossible à déterminer. On a retrouvé en Égypte des documents décrivant des scènes de pendaison bien avant les premiers pharaons. Elle était, semble-t-il, liée aux sacrifices humains. Il semble que sa première utilisation en tant que condamnation pénale remonte à la Rome Antique pour les chrétiens. C’est aussi par pendaison que Judas, après avoir trahi Jésus, se donne la mort. Dés le V e siècle, en Europe, elle devint le moyen d’exécution le plus utilisé pour les criminels de droit commun : simple et efficace, on exécutait en quelques minutes sans effusion de sang. A cette époque la technique était encore très rudimentaire : le condamné, les mains liées dans le dos, était assis sur le faîte de la branche d’un arbre. On lui passait la corde au cou, puis il suffisait de le faire basculer en arrière. Ce dispositif sommaire demeura en vigueur jusqu’à la fin du Moyen Âge. Le XV e siècle vit se réglementer l’utilisation de la pendaison, pour la confier à des personnes qualifiées : les bourreaux -les exécuteurs des haultes-oeuvres- . C’est à cette époque que les méthodes de pendaison se modernisèrent. On abandonna la pendaison aux arbres pour se rabattre sur des portiques spécialement prévus à cet effet: les potences. On commença également à s’intéresser aux moyens d’abréger les souffrances des pendus et on découvrit que la mort pouvait être quasi instantanée si la corde utilisée était suffisamment longue pour autoriser une grande chute avant la pendaison. Mais il fallait que le bourreau ait quelques notions de physique et d’anatomie pour éviter que la tête ne soit arrachée par le choc, ou à contrario, que la mort du supplicié ne soit trop longue par asphyxie. Dès lors, la condamnation à être pendu « haut et court » devint synonyme de supplice supplémentaire infligé au condamné. La méthode demeurait cependant assez artisanale, et le bourreau était toujours contraint de monter au sommet de la potence pour faire basculer les pendus. Les Anglais résolurent ce problème au XVI éme siècle avec l’invention du plancher coulissant ou « Long-drop »: les condamnés étaient placés au dessus de trappes dont l’ouverture était déclenchée sur ordre.


De l’histoire à la légende
Bien qu’elle ait été relativement rare, la peine de mort fut ordonnée à plusieurs reprises par le Prévôt de Beaumont, parfois sur l’avis du Grand Bailli du Hainaut. Entre 1398 et 1453, et entre 1464 et 1474, 31 peines capitales furent prononcées dans la Prévôté, dont plusieurs pendaisons. On faisait appel au bourreau de Mons pour exécuter les coupables.
La pendaison, comme dans d’autres villes hennuyères, était réservée aux voleurs et aux personnes coupables de brigandage (rançonnement sur les chemins, meurtre, menaces d’incendie, …) «Rawarder sur les chemins marchans et aultres que il avoient destourset et les aulcuns ranchonnet » (A.Musin). Les corps des coupables restaient à pourrir plusieurs mois sur la potence et des peines sévères étaient prévues aux gens qui viendraient à les dépendre : il fallait que l’infamie perdure.
Il faut remarquer que la pendaison semble avoir été réservée aux hommes : seules deux femmes furent condamnées à mort sur la période précitée, toutes deux au bûcher.
Nous ne pouvons déterminer avec certitude où se déroulaient habituellement les exécutions capitales, mais plusieurs semblent s’être passées « sur les champs ». Elles devaient donc probablement avoir lieu hors des remparts de la ville. Deux mentions dans les archives confirment cette hypothèse. La première renseigne les frais « pour aller quirire à le haie de Beaumont l’estake et amener à Beaumont où on la mist à point et de Beaumont remener à le justice ». L’autre stipule qu’après que l’épouse de Gilliart Gerart eût avoué s’être rendue coupable d’incendie à l’instigation de son mari, tous deux furent conduits à la justice. Mais comme celui-ci refusait de reconnaître sa culpabilité, il « fu ramenés à le ville ».
Le gibet nécessita à plusieurs reprises un entretien. Le compte de 1441- 1442 comprend une rubrique intitulée « Aultrez mises faites et payés (sic) par ledit prevost pour cause d’un gibet qu’il a fait faire au lieu de cellui de Beaumont qui estoit par poureture cheus ». La construction de ce gibet exigea la collaboration de pas moins de quarante personnes « pour ce ledit gibet aidier à drechier et mettre sus qui aultrement ne se pooit faire sans grande ayde pour ce qu’il estoit de gros membres et pesans » Pour leur peine, le prévôt les invita à la taverne. En 1471, deux charpentiers reçurent 12 livres pour avoir fait « ung noef gibet pour tant que ilz n’en y avait nulz audit Beaumont ».
Le « Besoigné », rédigé sur l’ordre de Charles de Croÿ en 1609-1610 signale qu’ « il n’y at audit Beaumont, sur le grandt marché ny par tout le terroir dudit lieu, aucun gibet dressé, de pierre ou de bois, ains lorsqu’il convient fayre la justice de quelque malfaiteur, il est dressé une petitte potence sur le terroir dudit Beaumont, du costé du lieu de la résidence dudit malfaiteur ». Ce n’est vraiment que pour nos Auvergnats que la pendaison a eu lieu sur la grand-place, mais il faut dire que le crime était aussi extraordinaire…
Nous pouvons donc conclure que durant le XV eme siècle, un gibet devait être présent à Beaumont, sans doute à l’extérieur des remparts. Comme les peines capitales furent relativement rares, cette construction, ayant dû être réparée plusieurs fois, a sans doute était abandonnée au XVII ème siècle au profit d’une « petite potence » dressée à proximité de la résidence du condamné, ou « aux champs » pour un étranger à Beaumont.

Les exécutions capitales donnent au bourreau l’occasion de rentrées financières non négligeables : il vend, souvent au prix fort, aux personnes qui viennent en secret, divers produits sensés porter bonheur ou soigner les maux.
La graisse des pendus est un baume puissant capable de guérir bien des maladies. Cette graisse est aussi employée, dans la main d’un pendu séchée au soleil, pour servir de lampe à huile. Elle a le pouvoir d’endormir quiconque en voit la lumière.
La corde du pendu est un porte-bonheur très efficace qui donne la chance au jeu à tous les coups.
Les ossements de criminels ont le pouvoir d’éloigner le mauvais sort. Ils sont quelques fois broyés en poudre, ainsi que le sang pour une utilisation en sorcellerie.
La mandragore, plante magique qui , selon la légende, fleurit à minuit sous la potence, a le pouvoir d’apporter la chance à son possesseur et de le protéger de tout maléfice. Sa racine est étrangement de forme quasi humaine. Il faut cependant s’en méfier, car elle apporte la mort à celui qui l’arrache du sol. On fait donc appel à des animaux pour la déterrer. Elle s’appelle également « mandegloire » ou « main-de-gloire ».
Les confréries militaires
Dans le cortège, vous pourrez apercevoir différents groupes armés qui représentent les anciennes confréries présentes à Beaumont lors de la visite de Charles-Quint en 1549. Ces confréries existent encore aujourd’hui et leur histoire est déjà fort ancienne.

Le groupe des hallebardiers
Beaumont possédait une milice communale, dont le châtelain avait le commandement.
Le Besoigné de 1608 donne quelques renseignements au sujet cette garde bourgeoise : elle se composait ordinairement de deux cents hommes portant des armes, répartis en vingt escadrons de dix hommes, sous la direction de trois capitaines, désignés par le prévôt au nom du seigneur; ces bourgeois étaient tenus de monter la garde en temps de guerre ; chaque garde ou patrouille était composée de dix hommes que l’on changeait alternativement.
Les anciens comptes de la recette de la maltôte font mention des sommes dépensées pour la garde de la ville. En 1640, Pierre Bartholomé reçoit 12 livres pour avoir fait le guet au clocher, à raison de 8 patards par jour. Le 28 septembre de la même année, il reçoit 48 sols pour avoir fait le guet neuf jours au passage des Lorrains. Les mêmes comptes renseignent une dépense de 48 livres payée à Pierre Haverland pour avoir amené des tonneaux de poudre et plusieurs livres de plomb de Mons à Beaumont, le 1er juin 1640
A partir de 1680, le guet fut confié à Barthélemi Lecomte, moyennant un gage annuel de 120 livres.
Un compte de la massarderie de 1793 renseigne une dépense de 6 livres 6 patards payée à Alexis Cantineau et à d’autres particuliers qui ont servi de guides à la troupe.
Le Besogné indique également que la ville disposait d’un certain nombre d’armes et de munitions : 22 piques et 21 arquebuses à crochets dans l’Hôtel de Ville, 3 tonnes de poudre et 22 livres de mèches dans la Tour Sainte Barbe, 4 arquebuses à crochets et 2 serpentines au Plouy. En temps de guerre, le Comte de Beaumont renforçait les défenses de la ville en réparant et améliorant les remparts et les portes et en les équipant en hommes et en armes.
Depuis 1830, une garde civique fut organisée à Beaumont mais elle n’a pas été maintenue en activité. L’état récapitulatif du registre d’inscription, formé au mois de janvier 1876, en exécution de l’article 661 de l’instruction générale de 1859, porte à 298 le chiffre total des hommes de 21 à 50 ans inscrits pour le service de la garde civique.
Pour la reconstitution de la légende de Beaumont, la « milice communale » est représentée par le groupe des hallebardiers. Cette compagnie d’environ 30 hommes est armée de hallebardes et commandée par le Capitaine « Le Boiteux ».
Les Serments
La ville de Beaumont posséda quatre associations armées, connues sous le nom de Serments. Ces associations rendirent de grands services à la ville et au seigneur, aussi obtinrent-elles des faveurs et des privilèges tout spéciaux.
Ainsi, les archers et les arbalétriers participaient à la garde renforcée lors des fêtes marchandes, de même que lorsqu’un danger menaçait : en 1443, des archers et des arbalétriers furent placés aux portes de Binche et du Ploich «pour doute des ecorcheurs ». Lors d’une exécution, une partie des membres des serments accompagnait le prévôt, l’autre partie assurant la garde à l’une des portes de la ville. Les confréries militaires aidaient aussi parfois le prévôt dans la poursuite et l’arrestation de malfaiteurs. A titre exceptionnel, elles pouvaient également seconder le tourier dans la garde des prisonniers. Elles prirent, en outre, part à la lutte contre les Gantois avec Philippe de Ternant. (1)
Parmi les privilèges dont ces corporations jouissaient, rappelons d’abord que les confrères de Saint Sébastien et de Saint Georges étaient exempts du droit de bourgeoisie. Cette prérogative fut changée par ordonnance du 5 juillet 1714 : ils obtinrent en échange l’exemption de tout droit de maltôte et d’afforage sur une pièce de vin et sur deux brassins de bière par année; de plus, le roy de la confrérie était affranchi du logement militaire, quand il n’y avait pas plus d’un régiment en garnison dans la place (2) . L’oiseau se tirait tous les ans la veille de la fête communale. Les sociétés touchaient de ce chef sur la caisse de la commune : celle de Saint Sébastien , treize livres, celle de Saint-Laurent, dix-huit livres. La confrérie de Saint-Georges n’existait plus depuis la seconde moitié du XVII e siècle.


Le serment des arbalestriers de Saint Georges
La plus ancienne de ces associations était le Serment des arbalétriers de Saint-Georges. Nous ne connaissons pas son origine; mais il existait au commencement du XIVe siècle.
Les confrères prirent part à divers concours organisés par d’autres serments du comté ; notamment a celui qui se donna à Valenciennes le 24 avril 1372 (3).
Ce serment disparut à l’époque des guerres de don Juan, dans la seconde moitié du XVIe siècle. « La dite confrairie, dit un ancien registre, at un fort beau collier d’argent doré où sont les armoiries de feu monseigneur le duc de Croy, lequel collier et oiseau a été donné par iceluy à la dite confrairie Saint-George, l’année qu’il fut Roi d’icelle, l’an 1561. Et comme du depuis la dite confrairie Saint-George est allée à néant, mon dit seigneur a donné alors le collier et oyseau à la dite confrairie Saint-Laurent , laquelle l’a toujours tenu en sa possession. Et sy appartient aussy à la dite confrairie une enseigne de taffetas rouge, blanc et jaune, avec un tambour et une casaque violette, pour leur serviteur. » (Description de la Ville et du Comté de Beaumont, éditée par E. MATHIEU dans Annales du Cercle Archéologique de Mons, t. 15, Mons, 1880).
Ce collier, véritable chef-d’œuvre d’orfèvrerie à présent revenu à la Confrérie, porte le millésime 1561 et se compose d’une chaîne formée d’un grand nombre de médaillons sur chacun desquels on lit :
J’Y PARVIENDRAI CROY.
RAISON LE VEULT HALLEWIN.
Il rappelle donc les devises des donateurs, Philippe de Croy et Jeanne de Hallewin.Une médaille d’un travail grossier est appendue à un des chaînons; elle offre à l’avers l’image de saint Laurent et au revers cette inscription :
CETTE MÉDAILLE A ESTÉ DONNÉE PAR LE SR. G. DUBOIS, R0Y 1713 ET 1714
Le Serment de Saint Georges fut rétabli en 1820; il possède un collier en argent avec trois médaillons, dont le premier offre la représentation de Saint-Georges, le second les armes de la maison de Caraman, le troisième porte cette inscription :
DONNÉ PAR M. LE C te MAURICE DE CARAMAN, G d MAITRE PROTECTEUR EN 1820, 1 ère ANNÉE DU RÉTABLISSEMENT DE CETTE CONFRAIRIE ÉRIGÉE EN LA VILLE DE BEAUMONT PAR SES ANCÊTRES.
En dessous de l’oiseau on lit :
CET OISEAU FUT DONNÉ PAR M. C. LAURENT, CONNÉTABLE, 1828.
Le serment des Archers de Saint Sébastien
Le Serment des archers de Saint-Sébastien remonte, croit-on, à 1320 et doit sa création à Jean de Hainaut, sire de Beaumont. Il comptait vingt-et-un confrères et avait son local devant la porte du Plouy ; sa charte d’érection disparut dans l’incendie du 9 juin 1598.
Par acte du 22 juin 1699, les confrères arrêtèrent de nouveaux statuts.
Un décret de Maximilien-Emmanuel, électeur de Bavière, daté de Saint-Cloud, le 20 août 1714, confirma les privilèges accordés au serment de Saint-Sébastien par les archiducs Albert et Isabelle, et déclara en conséquence que le roi, ayant abattu l’oiseau la veille de la dédicace, serait exempt des logements des gens de guerre, de guet et de garde, et que sa confrérie jouirait de l’exemption de tous droits attachés à une pièce de vin et à deux brassins de bière chaque année. (4).
La confrérie de Saint-Sébastien avait son autel dans la chapelle de Saint-Jean l’Évangeliste, où elle faisait dire une messe basse chaque semaine.
Ce serment possédait jadis une enseigne aux couleurs blanche, rouge et jaune avec la croix de Bourgogne. Cette Confrérie possédait anciennement un magnifique collier d’argent avec deux médaillons. Le premier représentait saint Sébastien martyr, le second portait cette inscription :
DON DE M. MAURICE DE CARAMAN A LA SOCIÉTÉ SAINT-SÉBASTIEN, A BEAUMONT. 1808.
Cette pièce disparut malheureusement durant la seconde guerre mondiale. Sur base de photographies, les Confrères de Saint Sébastien en ont cependant fait réaliser une réplique. La Confrérie possède également de son saint patron une intéressante statue de bois polychrome du 18ème siècle.

Le Serment des archers de Sainte Christine
Un autre serment d’archers, dit la confrérie de Sainte-Christine, avait disparu pendant les guerres de don Juan. Le besoigné de 1608 mentionne seulement son nom et fait remarquer qu’elle est allée à néant et que son collier a été vendu pour payer une dépense de bouche.

La Confrérie du martyr et ami de Dieu Monsieur Saint Laurent
La confrérie des arquebusiers de Saint-Laurent fut érigée le 12 juillet 1514; Guillaume de Croy en approuva ses statuts le jour de la Saint Laurent (11août) en 1601.
Les Confrères fondateurs s’étaient fixé d’ambitieux objectifs. Selon le texte de 1601, ils agissaient « pour l’honneur et révérence de nostre mère saincte Esglise, et par espécial pour la décoration dudict saint Laurens, et le salut de leurs âmes, et aussy pour l’entretènement du jeu de la culverinne, et mesmement pour le bien et défence, garde, conservation, et seureté de nostre dicte ville de Beaumont » (Description de la Ville et du Comté de Beaumont, éditée par E. MATHIEU dans Annales du Cercle Archéologique de Mons, t. 15, Mons, 1880 p.204)
Les Arquebusiers ou Culvériniers de Saint Laurent maintinrent leur Confrérie jusqu’en 1939. C’est à l’occasion des fêtes de Charles Quint de 1985 qu’une poignée d’enthousiastes lui redonnèrent vie.
BERNIER, Th., Histoire de la Ville de Beaumont, dans Mémoires et Publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, 4ème série, t. 4, Mons, 1879, p. 117-367.
(1) A.MUSIN « Justice et criminalité dans la prévôté de Beaumont (1398-1474) – Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Licencié en Histoire, Université catholique de Louvain, 2002-2003
(2) Registre des bourgeois de Beaumont, Archives communales de cette ville
(3) Essai sur l’organisation militaire de la ville de Valenciennes 1067-1780, dans les Mémoires historiques sur l’arrondissement de Valenciennes, publication de la Société d’Agriculture, etc. t. IV, p. 51 .
(4) Gachard, Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3eme série, t. il, p. 539
Les gagnolets
Il est, à Beaumont, une tradition beaucoup plus ancienne encore que celle des macarons mais qui, malheureusement, tend à disparaître : les « gagnolets ». Ce mot « gagnolet » a supplanté dans les archives à la fin du XVIIIe siècle l’ancien terme qui était « escaudi » (échaudé). C’est un pain circulaire dont la pâte rappelle celle de nos « cougnous » (galette fabriquée durant les fêtes de Noël). Ce pain, légèrement troué au milieu, est acheté chez le boulanger, béni l’après-midi du Jeudi Saint et distribué aux enfants qui passent une ficelle dans le trou afin de le pendre à leur cou.
F. Dumont (1), historien local maintenant décédé, avait décrit la bénédiction des gagnolets, célébrée en pleine crise révolutionnaire, en 1800.
« La représentation de la Cène, qui se faisait l’après-midi du jeudi Saint et s’accompagnait d’une distribution de vin et de petits pains bénits appelés « gagnolets » ou « échaudés » était une vieille coutume beaumontoise remontant pour le moins au XVe siècle. Le compte de l’Eglise de 1714 nous apprend qu’il y avait à cette époque deux espèces « d’escaudis », les grands à un patar la pièce et les petits, réservés aux « apôtres » et aux « enfants d’escolle ». Cette coutume, …, n’a cependant pas entièrement disparu. Il n’y a plus de représentation de la Cène, par conséquent plus « d’apôtres ». Plus de distribution de vin. Mais les « enfants d’escolle » apportent encore au prêtre, qui les bénit, un gagnolet,…, plus ou moins percé en son centre, qu’ils ont acheté chez le boulanger et dont la pâte rappelle celle des « cuquelins » comme on appelle ici les « cougnous » de Noël. L’humble rite, aimé des enfants, aura montré plus de vitalité que les fêtes décadaires et les mariages républicains, la fête de la souveraineté du peuple, celle de la « juste punition » du dernier des rois et autres jeux, parfois sinistres, des grandes personnes ».
Pour que ne meure pas la tradition, le Comité Charles-Quint, dans le cortège de 2005, a fait accompagner le Mambour de la paroisse Saint Servais de quelques enfants ayant un « gagnolet » pendu au cou. Malheureusement pour eux, ils ont dû attendre la fin du cortège pour dévorer à pleines dents ce délicieux petit pain.
(1) F. DUMONT, le canton de Beaumont sous le Directoire, dans Mémoires de la Société des Sciences, Arts et Lettres du Hainaut, 71e volume, 1958, p. 43.
Lettre à Marie de Hongrie
Nous avons retrouvé, dans des archives longtemps oubliées, une lettre que l’empereur Charles-Quint a écrite à sa soeur Marie de Hongrie, peu après son arrivée à Beaumont le 21 août 1549. (1)
Beaumont, ce 21 du mois d’aoust 1549
Une journée de plus d’un long périple, de routes poudreuses, de soleil écrasant. Une journée de plus où ma vieille blessure m’a tiraillé la jambe, maudit souvenir de cette ancienne chute. Mais j’ai gardé le cheval toute la matinée, depuis notre départ de Mariembourg de bonne heure, jusqu’au moment du dîner à Rance.
Nous y avons, ma foi, délicieusement mangé. On prépare ici le poisson de rivière d’une façon qui n’est pas sans rappeler notre escabecha espagnole. Il s’agissait d’anguilles coupées en brefs tronçons et marinées dans une sauce pimentée de vin aigre et d’oignons, où l’on ajoute quelques herbes. La préparation est assez relevée et pleine de goût. Ceux d’ici la nomment plaisamment escaviches ou escavêches. Philippe, mon bon fils, qui siégeait à ma droite, les a bien appréciées.
Il fut moins enthousiaste au moment des charcuteries. Des jambons et des pâtés comme s’il en pleuvait. Le tout s’arrosait d’une bonne bière noire, encore assez forte, que boivent les gens d’ici. J’en ai repris à trois fois, tant les poussières du chemin m’avaient desséché le gosier. Philippe n’y a pas touché. Vous savez bien, ma sœur, combien votre neveu est de goût difficile. Il se satisfait d’un peu de vin, bien souvent coupé d’eau. Avec cet air sentencieux qui me déplaît tant, il affirme bien haut qu’un bon vin stimule le corps et l’esprit, à condition (s’empresse-t-il d’ajouter) de le boire lentement et en petite quantité. Je prétends pour ma part que la bière donne aux visages un teint joyeux et aide à la digestion des mets les plus copieux. Et puis, comme je le dis toujours, le sang de la vigne me convient moins bien que la fille de l’orge. Ce qui chagrine un peu Monsieur Vésale, mon médecin.
Après ces agapes, nous avons repris la route sans tarder. Malgré le vacarme de l’escorte, je crois avoir somnolé quelque peu. Et vers six heures de relevée, nous avons vu Beaumont, d’une hauteur nommée Falin.
La ville avait fière allure. On voyait au loin les clochers de l’église paroissiale et de la chapelle du cimetière ainsi que les murailles qui enserrent le bâti sur une longueur d’onze cents toises. Nous avons laissé à senestre la belle Tour Sainte Barbe (qui sert de magasin à poudre) et l’antique donjon de la comtesse Richilde. C’est une tour énorme et carrée, qui touche au palais du Comte Charles. Elle se nomme la Salamandre, animal que l’on rencontre encore volontiers dans les taillis des environs. Les gens d’ici s’en méfient pourtant, considérant la bête comme animal du diable (c’est pourquoi sans doute le roi des Français l’a choisie comme emblème).
Lorsqu’enfin nous avons franchi la Porte de France sur le dessus de la Ville, toute la population de Beaumont nous attendait. Me croiras-tu si je te dis, ma bien chère sœur, que chacune des trois cents façades du clos était décorée de bannières et de guirlandes de fleurs, tant que nous ne pouvions plus voir que des maisons blanches et rouges ? Partout nous étions acclamés, partout nous étions applaudis. Ce n’était que des « Vive l’Empereur » et des « Vive notre Souverain ». Dans les rues, on entendait des airs de musique et l’on voyait les jeunes gens danser. Comme ces Beaumontois semblent joyeux lurons !
Sur le Grand Marché, notre fidèle Comte Charles de Croy nous a accueillis de manière fort digne. Son château de Beaumont est un bien bel édifice, qui n’est pas loin de valoir, ma sœur, votre résidence de Binche. Le Comte a coutume de dire que son palais est si beau que Dieu lui-même le prendrait pour logis si d’aventure il revenait sur terre. Vous connaissez sa gouaille, Marie, et son sens des formules.
Il nous a fait servir au souper des volailles mijotées dans la crème de lait. Un délice. Chaque morceau embaumait l’estragon et s’accompagnait de curieux biscuits ronds à la pâte d’amandes. Au dessert, le Comte nous a donné à goûter un gâteau bien original, alternant le pain d’épices, la crème et le massepain. Sur le dessus, le Comte avait fait sculpter en médaillon mon propre portrait… en chocolat ! Vous savez, cet extrait de cacao venu du Nouveau Monde. Mon Dieu que cela était bon. Voilà la plus douce manière de clore une journée éprouvante.
Sur l’avis de mon médecin, je termine maintenant mon bouillon de légumes.
Il est déjà bien tard. Je n’entends plus les pas du couloir : je gage que mes gardes s’endorment devant ma porte. Leur sommeil est profond mais leur oreille est fine. J’ai pleine confiance en eux.
Quelques marchands circulent encore en ville, je les entends qui s’affairent à la foire de demain.
Ce dimanche sera une belle journée. Si ma jambe le permet, j’irai chevaucher un peu dans les campagnes d’ici. Vous ai-je dit, ma soeur, qu’elles sont assez vallonnées et gentiment bucoliques ? J’irai y voir dès l’aube.
Nous reprendrons la route après-demain pour Binche où je pourrai enfin vous serrer dans mes bras.
Bien à vous, ma sœur,
Votre Charles

Lettre à Charles de Croÿ
Nous avons (après la lettre à sa sœur Marie) retrouvé, dans des archives longtemps oubliées, une nouvelle lettre que l’empereur Charles-Quint a écrite au seigneur de Beaumont, peu après son départ pour Binche.
Décidément, les archives beaumontoises regorgent de trésors manuscrits.(1)
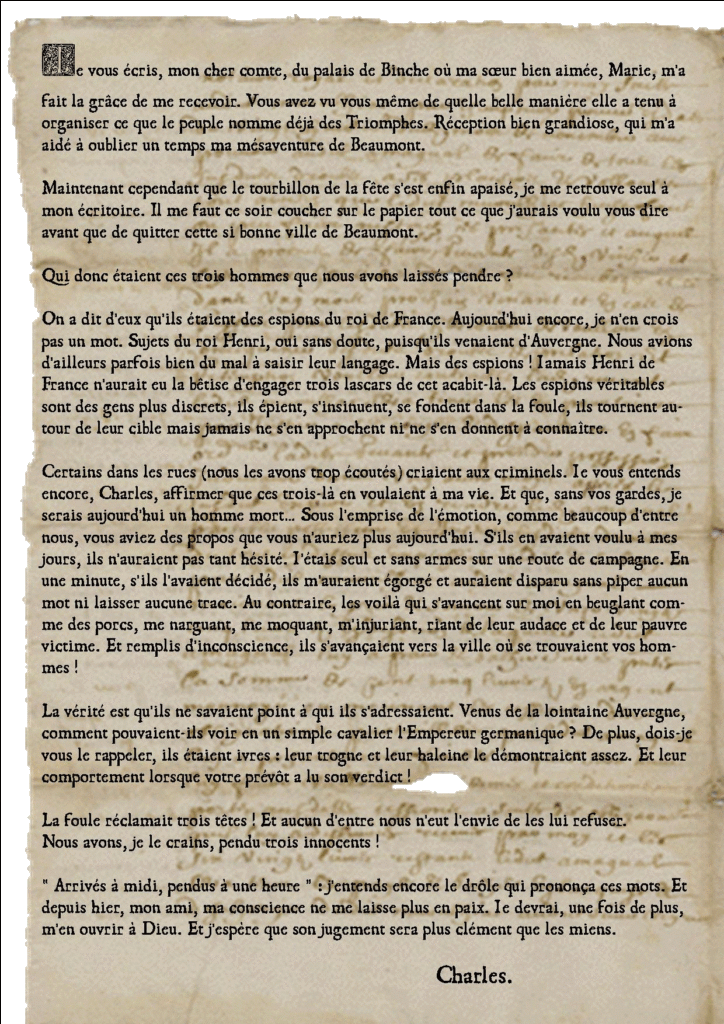
(1) « Ces lettres sont des faux ! », dénonce un historien local. Nous sommes entièrement de son avis !
Charles-Quint et les hérétiques
par Cécile Dumont, docteur en histoire
A la fin d’octobre 1548, ayant pris place dans une mauvaise voiture, quatre voyageurs, deux hommes et deux femmes, quittent Mons discrètement par la porte du Parc. Ils prennent la direction de Tournai, première étape vers l’Angleterre, et première étape vers le salut. Car Augustin Dumarchiet et Nicolas Larchier – c’est ainsi que se nomment les deux fuyards, l’un et l’autre étant accompagné de son épouse – sont des protestants notoires, qui vivent dans la clandestinité et qui, pour échapper aux persécutions, voyagent sans cesse. Hélas, ils n’iront plus bien loin.
La répression du protestantisme et l’odieux massacre des protestants furent à peu près aussi impitoyables sous Charles Quint que sous Philippe II. Les faits sont seulement un peu moins connus. Mais c’est sous Charles Quint que l’Inquisition, qui existait depuis très longtemps en Hainaut, prit l’allure d’une véritable institution et devint un instrument politique. Son rôle était d’arrêter les suspects, de les interroger et accessoirement d’obtenir leur abjuration. Les jugements étaient surtout l’œuvre du Conseil Souverain, tribunal suprême sans doute, mais cour ordinaire et non tribunal d’exception.
Le Conseil Souverain était présidé par le Grand Bailli. Il importe de savoir ici que, de 1537 à 1551, cet officier n’était autre que Philippe de Croy, seigneur de Beaumont et de Chimay seigneur aussi, entre autres lieux, de Château-Porcien dans les Ardennes (près de Rethel). Pendant quelques années, Philippe de Croy s’est démis de sa charge mais c’était pour la céder, ainsi qu’il lui était permis, à son fils aîné Charles, futur seigneur de Beaumont.
Revenons à nos fuyards. Ils sont dénoncés et Philippe de Croy dépêche aussitôt le prévôt de Mons à leur poursuite. L’arrestation a lieu entre Quevaucamps et Stambruges mais Augustin Dumarchiet réussit à s’échapper. Pour les trois autres, c’est le cachot, au château de Mons. Il y a donc là Nicolas Larchier, sa femme. Barbe Couppe, originaire de Beaumont et Marion Fournier, de Quévy-le-Grand, épouse du Montois Augustin Dumarchiet. En ce temps où les ordonnances impériales visent autant sinon plus à la destruction des hérétiques qu’à celle de l’hérésie, ces malheureux ont bien peu de chances de survivre.
Nicolas Larchier est natif de Château-Porcien. Il a séjourné à Strasbourg et Genève. Prédicateur enthousiaste, autant qu’enthousiasmant, «homme de savoir» et d’une grande culture, il fait montre d’un véritable héroïsme. Face à l’inquisition d’abord, face aux juges ensuite et bien que n’entretenant aucune illusion sur son sort personnel, il s’efforce de justifier sa conduite en ne reniant rien de ce qui a pu la motiver. Il a jadis étudié la théologie, est passé à la réforme et revendique son entière responsabilité. Condamné, il refuse de livrer les noms de ses amis et tente de mettre hors de cause son épouse, Barbe Couppe. Celle-ci aura d’ailleurs la vie sauve, après une enquête menée dans sa famille à Beaumont. Nicolas Larchier est exécuté sur la Grand-Place de Mons et Marion Fournier, qu’il n’a pu sauver, subit le même sort.
Augustin Dumarchiet a-t-il espéré trouver un refuge à Beaumont? C’est là en tout cas qu’il est arrêté, quelques semaines après la fin tragique de son ami Larchier. Lui aussi est jugé à Mons, mais ensuite ramené à Beaumont pour y être emprisonné. Charles Quint refusera finalement sa grâce, après deux ans de réflexion et Dumarchiet sera exécuté sur une colline proche de notre ville. Responsable de la sentence de mort, Philippe de Croy ne lui aura pas survécu. Il a été assassiné à Quiévrain de « traîtreuse manière » et de son cachot (probablement de celui de la porte de Binche), le pauvre Dumarchiet a dû percevoir quelques échos de ses majestueuses funérailles. Vingt-neuf ans plus tard, rappelons-le, un autre seigneur de Beaumont, petit-fils de cet inexorable Philippe, pourra se convertir, sans danger particulier, au protestantisme.
Si on en croit Gachard, premier archiviste général du Royaume et grand historien s’il en fut, des idées de tolérance auraient déjà circulé dans les masses et le peuple de chez nous disait et allait dire très longtemps « qu’il y avait de la tyrannie à violenter les consciences et qu’il était barbare de punir de mort des opinions dont Dieu seul était juge». La législation sanguinaire de l’empereur aurait donc heurté quelques consciences. Serait-ce pour cela qu’elle nous a laissé, par l’entremise d’une légende, le souvenir d’une grande rigueur et celui d’une injustice? On ne peut de toute manière comparer en rien les héros de la Réforme aux Auvergnats de notre légende.
E. MAHIEU, « Le protestantisme à Mons des origines à 1575 », Annales du Cercle Archéologique de Mons, t. 66, 1967
L. DEVILLERS, Inventaire des archives de ta ville de Mons, t. III, Mons. 1896.
